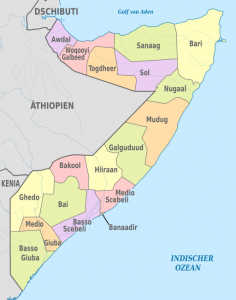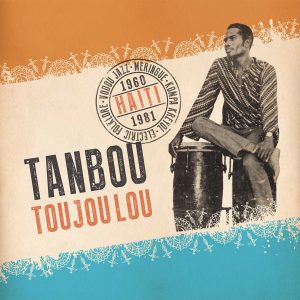Osman et Ayana ont tous les deux
vécus à Mogadiscio. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont en commun
d’avoir connu la musique somalienne sous l’ère Siad Barre. Si l’un a fui
le pays après la guerre civile de 1991, l’autre y vit toujours
aujourd’hui. Ils gardent dans leurs souvenirs, l’image d’une ville
festive et riche en cultures. Les divers conflits ont effacé beaucoup de
traces de cette « belle époque », mais pas leurs témoignages.
« Vivre à Mogadiscio c’était le paradis !
», Osman Aden Khalif ne mâche pas ses mots. Sous le régime militaire du
général Siad Barre (1969-1991), il a vécu quelques-unes de ses plus
belles années en Somalie. Les terrasses de café étaient remplies, les
fêtards se retrouvaient dans les théâtres et les hôtels, les chansons du
Dur Dur Band envahissaient les ondes. En se remémorant ces doux
souvenirs, Osman ne peut s’empêcher de sourire. Désormais installé en
Belgique, il a accepté de nous raconter sa version de Mogadiscio. Ne
parlant pas français, il a demandé à son neveu Ilyas Ibrahim de
s’improviser traducteur le temps de l’interview. Ce dernier nous a donné
rendez-vous avec son oncle à Molenbeek-Saint-Jean, au sein de l’ASBL Horizon Sud dont il est le président.
Bonjour Osman ! Pouvez-vous vous présenter s’il vous plaît ?
Je m’appelle Osman Aden Khalif, je suis
né à Mogadiscio le 1er octobre 1958. J’ai beaucoup bougé dans ma vie.
J’ai vécu en Somalie, en Corée du Sud, en Italie, en Belgique…
Quel souvenir gardez-vous de Mogadiscio avant la guerre civile de 1991 ?
C’était vraiment bien ! Une superbe
ville. Mon enfance était radieuse, c’était une autre époque, une autre
génération. Mon père était commerçant et ma mère était au foyer comme
beaucoup de mères somaliennes. Je me rappelle d’une belle jeunesse. Que
ce soit au niveau de l’éducation, la santé, tout était très encadré à
l’époque. Aujourd’hui, tout a changé avec la guerre civile. Nous vivions
vraiment bien, surtout au début de l’ère Mohamed Siad Barre.
La musique avait-elle une place importante à cette époque ?
Complètement ! Je n’étais pas le plus
grand fan de musique, mais comme tous les habitants de Mogadiscio, on en
entendait tout le temps. J’avais la vingtaine quand la scène musicale a
vraiment émergé là-bas. Dans les années 1970, la Somalie était un grand
pays à l’échelle continentale. La musique somalienne était très connue
et très appréciée dans l’Afrique de l’Est. Il y avait des compétitions
musicales entre les pays voisins, c’était du sérieux. C’était
généralement le Soudan et le Somalie qui se retrouvaient en finale. Il y
avait de grands chanteurs qui menaient la compétition. Je me souviens
de Mohamed Suleiman Tubeec, par exemple.
Y avait-il beaucoup de concerts dans la capitale ?
Oui, mais pas seulement à Mogadiscio. La
Somalie est composée de dix-huit régions, il y avait des groupes
d’artistes connus à l’échelle nationale. Ils partaient à travers tout le
pays pour jouer. Le point de départ de ces tournées était généralement
au nord du pays, dans une ville portuaire qui s’appelle Berbera.
Le Dur-Dur Band, cela vous parle ?
Ah oui ! Mais ça se prononce « Dour-Dour »
(rires). Ils passaient tout le temps à la radio. Cela fait longtemps
que je n’ai pas écouté ça !
Vous voulez en écouter ?
Ce serait super ! Allez-y !
(Nous mettons la chanson « Fagfagley »)
Nous n’avons qu’une seule langue
officielle qui est le Somali, mais il y a plein de dialectes en Somalie.
Un nordiste avait souvent du mal à comprendre un sudiste. Et le Dur-Dur
Band avait plutôt tendance à chanter en langue sudiste.
Mais vous comprenez les paroles ?
Oui, parfaitement (rires). C’est une
chanson d’amour, et l’homme qui chante est en train de vanter sa
bien-aimée en la qualifiant de perle rare. Il la décrit comme une femme
très dynamique, et à l’époque, l’émancipation des femmes était peu peu
commune. Dans la chanson, le chanteur raconte qu’elle serait même
capable de conduire une voiture, tellement elle est parfaite.
Ah oui ça fait un peu vieux jeu dit comme ça ! Les femmes avaient-elles leur place dans la musique ?
Absolument ! Il y avait la chanteuse
Magool, par exemple. On l’appelait « la voix douce ». Elle avait la plus
belle voix de tous les artistes de l’époque. Il y avait aussi Maryam
Mursal qui chantait avec l’orchestre national Waaberi. Quelques
chanteuses étaient réputées à l’international. Maryam Mursal en faisait
partie. Elle était sous contrat avec le label de Peter Gabriel, Real
World Records.
Et fin 80, Mogadiscio c’était toujours le paradis ?
Non non non ! Le niveau de vie avait
baissé de manière considérable à la fin de la décennie. La « belle
époque » était finie.
Vous avez vécu la guerre civile de 1991 ?
Oui, mais je n’ai pas pris le fusil,
heureusement. Je ne faisais pas partie des membres rebelles non plus. Il
y avait des exodes dans tous les sens. Certains se sont orientés vers
la mer. Les gens quittaient la capitale pour la province. Tout le monde
allait dans sa tribu. J’ai d’abord quitté Mogadiscio pour le nord quand
le régime de Mohamed Siad Barre est tombé en janvier 1991. Puis, j’ai
quitté le nord parce que ça chauffait trop, et je suis allé au sud. On
partait comme on pouvait, parfois à pied. J’ai définitivement quitté le pays en 1998.
Selon vous, la guerre civile a-t-elle effacé le patrimoine culturel somalien ?
Non ! Certes, La guerre a déstructuré le
pays, mais la danse, la musique et tout le patrimoine culturel perdure.
Les Somaliens sont toujours très proches de leurs traditions, leur
musique. C’est effectivement moins encadré, mais vous allez découvrir
que rien n’a disparu en cherchant bien.
Que pensez-vous de l’état actuel du pays ?
La Somalie était considérée comme étant
le paradis sur terre des pays africains des années 1960 aux années 1980.
C’est le pays d’Afrique qui a la plus grande côte maritime. Il y a deux
fleuves, le pétrole, le gaz naturel, du bétail, … La Somalie était un
pays riche. Aujourd’hui, la réputation de la Somalie est négative, mais
il faut nuancer certaines choses. Dans les médias, on nous parle que des
pirates et des terroristes. En fait, pas mal de pays, surtout les pays
limitrophes, ont profité du chaos somalien après la chute de Mohammed
Siad Barre. Chaque pays a, à sa manière essayé de voler les ressources
du pays. Quand vous voyez des bateaux de pêche industrielle se ramener
sur vos côtes et vider le fond marin, c’est normal de riposter. Et la
riposte ça a été la piraterie. La culture et les bonnes choses qui
émanent de la Somalie ne sont pas visibles au niveau international.
C’est vraiment dommage !
Qu’est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que des amateurs de musique s’intéressent à celle de la Somalie ?
Je suis agréablement surpris pour tout
vous dire. Je pensais pas qu’un Européen viendrait un jour m’interviewer
sur le sujet. C’est génial de montrer une face un peu oubliée d’un
pays. Tout à l’heure, j’étais étonné quand vous êtes rentré dans la
pièce parce que je pensais que vous seriez africain (rires). Je suis
encore plus content qu’une personne étrangère à nos coutumes s’intéresse
à la musique somalienne. Merci beaucoup !
Exit la
Belgique, direction Mogadiscio maintenant. Ayana Abdi vit encore dans la
capitale somalienne. Elle y est née en 1975, mais contrairement Osman
Aden Khalif, elle est toujours restée dans la région de la Corne de
l’Afrique. Travaillant pour des ONG en tant que médecin, elle espère
qu’un jour Mogadiscio pourra redevenir « la perle de l’Océan Indien ».
Nous l’avons contactée via son fils, qui
lui, habite près de Liège, en Belgique. À l’instar de la précédente
interview, ce dernier a accepté de s’inventer traducteur le temps d’un
appel vidéo.

Ayana Abdi (à droite) et son fils © Abdinasir Hussein Dahir
Bonjour Ayana ! Comment ça va à Mogadiscio ?
Pour l’instant ça va, même si c’est
compliqué de temps en temps. Un jour, tout peut très bien aller. Le
lendemain il peut y avoir une bombe qui explose, un attentat, un
enlèvement, …
Aujourd’hui par exemple, tout va bien !
Que faîtes-vous à Mogadiscio ?
Je travaille comme médecin dans une
clinique et à domicile. Je suis également en contact avec des ONG sur
place afin d’améliorer la situation sanitaire.
Cela fait combien de temps que vous vivez ici ?
Depuis que j’y suis née (rires), c’est à
dire en 1975. J’ai fait mes études de médecine à Mogadiscio, j’ai
toujours voulu y rester.
La ville a dû changer considérablement ?
Pendant le début de l’ère Siad Barré,
c’était paisible ! On sortait beaucoup. On allait au théâtre, au cinéma,
dans les stades de foot.
Les concerts aussi ?
Oui, bien sûr ! J’étais une habituée du
Théâtre National. C’est là que la plupart des grands artistes se
produisaient. Je me souviens qu’il y a eu le Dur-Dur Band, Waaberi,
Magool, notamment. Je suis nostalgique de ces années-là. À partir de
1991, tout est parti en fumée. Il y a des bombardements et le Théâtre
National a d’ailleurs été détruit.
Malgré la guerre, tu es quand même restée ?
Oui ! Mon père a emmené mes frères et
sœurs se réfugier en Europe. Avec ma mère, on a décidé de rester à
Mogadiscio. On avait des amis à Djibouti et au Somaliland. Dès que ça
chauffait trop ici, on s’exilait chez eux un petit temps.
Pour revenir à la musique, les Somaliens écoutent encore aujourd’hui des groupes de l’époque ?
Absolument ! Même si la plupart des ces
artistes ne sont plus de ce monde aujourd’hui, ils sont toujours très
écoutés. Sur Youtube, on retrouve pas mal de sons. C’est la fierté
nationale d’avoir eu des musiciens comme eux.
Y a-t-il encore une scène musicale à Mogadiscio ?
La culture musicale ne s’est pas effacée
malgré les conflits. Il y a des nouveaux artistes qui sont en train
d’émerger en ce moment. Un peu partout dans la ville, des concerts
s’organisent discrètement, à l’abri des regards. Dans des caves ou des
lieux tenus secrets. Il faut faire très attention avec cela. Depuis des
années, les évènements musicaux sont malheureusement interdits.
On est loin de la « belle époque » en effet !
La mentalité a complètement changé depuis
! Avant, tu pouvais aller à la plage en maillot, maintenant, tout le
monde te regarde de travers si tu montres un peu de ta peau.
Ton fils arrive à venir te voir de temps en temps ?
On a une tradition chez nous les Somalis,
c’est que les enfants doivent de temps en temps revenir au pays. C’est
ce qu’on pourrait appeler le retour au bled pour les enfants partis
vivre à l’étranger (rires). C’est surtout pour leur faire comprendre
qu’ils ont de la chance. Je vous assure que ça marche à chaque fois.
(Son fils approuve) : « Je suis revenu en 2006, c’était un choc. La liberté, c’est quelque chose qui leur est étranger maintenant ».