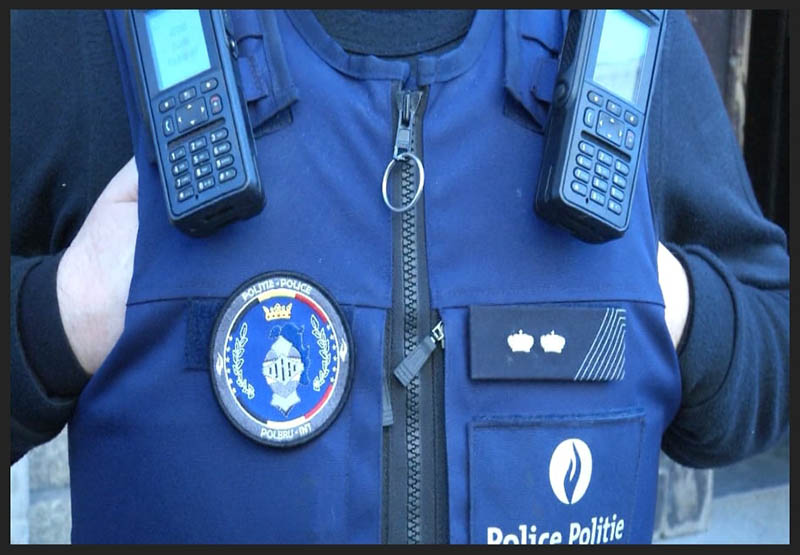Non, c’est non
Récits de femmes au cœur d’une procédure judiciaire : le cas des agressions sexuelles
CHAPITRE I : SARAH, ANNA ET ANAËLLE
Les agressions
Porter plainte n’est pas chose aisée. « Déjà quand on se fait voler son sac on n’a pas forcément envie de porter plainte… Alors imaginez une victime d’un acte de violence qui touche l’intimité sexuelle », affirme une psychologue du Centre de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles (CPVS) à Bruxelles. Il est très difficile de demander de l’aide et encore plus de mobiliser son énergie pour aller enclencher une procédure judiciaire avec l’espoir de retrouver un auteur qui est peut-être inconnu. « Et puis, porter plainte provoque de grosses questions telles que « comment l’entourage va-t-il réagir ? Est-ce qu’ils vont me croire… ? » », ajoute la psychologue.
Une seconde victimisation
Certaines femmes souhaitent éviter une seconde victimisation. L’agression en est une. Mais étaler sa vie privée dans l’espace public en est une autre. Pour Anna, dont l’agression a été filmée, il est impensable de rendre cette vidéo publique. Pourtant, dans certains cas, il est possible d’obtenir un procès en huis clos, notamment « lorsque les faits sont outrageants pour la victime ou lorsque celle-ci est mineure. Le prévenu peut aussi en faire la demande mais généralement c’est refusé », explique Denis Goeman, porte-parole du substitut du procureur du Roi.
Était-ce ma faute ?
« Était-ce ma faute ? » Très souvent ces femmes se jugent « coupables ». Coupables d’avoir provoqué la situation. « C’est un sentiment réel que ces femmes ressentent », explique Denis Goeman. Il poursuit : « mais ce sont elles les victimes. Sans une plainte on ne peut pas faire grand chose, c’est pour ça qu’il faut porter plainte, car sans la police il n’y a pas d’enquête. »
CHAPITRE II : GABRIELLE
La plainte

De par son ampleur, il est facile de penser que le phénomène #MeToo a permis aux femmes de franchir le seuil des commissariats. Pourtant, le manque de données chiffrées à ce jour et la jeunesse du mouvement font qu’il est impossible de l’affirmer. Si le mouvement a envahi la twittosphère, il n’a pas pour autant atteint toutes les strates de la société.
Chemises blanches, gilets pare-balles bleus, képis largement enfoncés sur la tête, quatre yeux fixes et deux carrures imposantes gardent l’entrée. Gabrielle s’engouffre dans les lieux.
« C’est à quel sujet ? », grommelle un homme derrière une vitre sale.
« Je veux porter plainte… pour une agression sexuelle », répond Gabrielle d’une petite voix.
« Oui ok, attendez juste ici », réplique-t-il.
« Cette structure matérielle n’est pas adaptée pour recevoir des victimes, avoue le commissaire bruxellois Olivier Slosse. Ce n’est déjà pas facile de s’exprimer sur son agression, alors le dire à un inconnu au travers d’une vitre dans une salle remplie d’individus qui attendent leur tour, c’est pas l’idéal », poursuit-il.
Elle s’assied sur une vieille chaise en plastique orange. Ses cheveux sont tenus par un petit élastique noir duquel s’échappent quelques mèches.
Un « bip » sonore retentit avant qu’un homme de grande taille en uniforme ouvre la porte.
« Mademoiselle, vous pouvez venir avec moi », dit-il en s’adressant à Gabrielle.
La jeune fille se lève et suit le policier. Dans les bureaux au premier étage du bâtiment, le matériel est vétuste et sent la poussière. Les grandes fenêtres du fond viennent apporter quelques jets de lumière dans la salle. La victime s’assoit à contre-jour. L’inspecteur rassure sa victime avant de commencer. « Vous savez vous pouvez tout dire, rien ne sortira d’ici », lui dit-il. « Ça va vous êtes bien comme ça ? Vous voulez plus de lumière ? », demande-t-il en jouant avec sa lampe de bureau.
Le courage de se plaindre
Lorsqu’une victime se présente au commissariat, « les faits ne sont jamais très clairs, c’est rare d’entendre « hier à 9h45 je me promenais à tel endroit et un homme habillé avec un pull rouge mesurant 1m85 est arrivé par-là” », explique l’inspecteur Ruggieri. Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc. « Il y a de l’alcool, des stupéfiants, des choses non dites. Alors, il faut laisser parler la victime afin d’éviter qu’elle ne soit coupée dans le peu de souvenirs qu’elle a », rajoute-t-il.
Gabrielle entame son récit. Chaque mot sorti de la bouche de la jeune fille est retranscrit par le bruit abrutissant des doigts de l’inspecteur sur le clavier de son ordinateur. Il prend le temps d’écouter, interrompt la victime puis écrit ce qu’il a entendu.
Ce soir-là, elle est de sortie avec ses copines. Vers 1h30, elle quitte la soirée. Le ciel est sombre et lourd. Alors qu’elle remonte le chemin qui mène au pont de Delta, elle entend encore derrière elle quelques sons s’échapper des portes battantes. Inquiète à l’idée de rentrer seule, elle décide une fois sur le pont d’attraper un taxi au vol. Quelques minutes suffisent pour que l’un d’eux s’arrête près d’elle. Elle ouvre la portière puis s’installe à l’avant en indiquant son adresse au chauffeur. Dans l’habitacle, Gabrielle ne perçoit que la joue droite du conducteur alors éclairée par la faible lumière d’un réverbère. Le visage du chauffeur sort complètement de la pénombre lorsqu’il tente soudainement d’embrasser la jeune fille. Un souffle d’anxiété envahit Gabrielle, sentant le visage de l’homme se rapprocher. Elle tourne la tête. Malgré son refus, le chauffeur persiste. Plus un mot. Seul le sentiment de peur flotte aux dessus de la tête de la jeune fille. Sa main gauche sur le volant, il met sa main droite sur la poitrine de la jeune fille avant de la laisser glisser lentement dans son entrejambe. Gabrielle se raidit.
« Gratte-moi le ventre », lui demande-t-il.
Elle s’exécute d’un geste mal assuré.
« Descend ta main », lui ordonne-t-il approchant de nouveau ses lèvres vers la jeune fille.
Apeurée, Gabrielle descend sa main, maintenant moite. Lorsqu’elle sent sous ses doigt le pénis du conducteur, elle la retire d’un geste sec. Son cœur bat de plus en plus fort. Elle lève les yeux. Elle reconnait le quartier de la Bascule où elle doit descendre. À l’arrêt d’un feu rouge, Gabrielle profite de l’instant pour sortir précipitamment.
Une longue procédure
Contrairement aux stéréotypes existants sur le policier qui court derrière le voleur, dans ce service, leur plus belle arme est le clavier d’ordinateur. Recherches, profilages, démarches juridiques, recueils de plaintes… Pour Nicolas Ruggieri, « c’est grâce à cet instrument qu’on peut coincer un maximum de personnes. Une balle à la fois jusqu’à ce que l’auteur du crime soit par terre ».
Une fois que le policier a rédigé le dépôt de plainte, il le fait relire à la victime. Celle-ci signe pour marquer son accord. L’inspecteur appose également sa signature puis tamponne le document.
Les chaises crissent sur le sol. La victime se lève et le policier la raccompagne jusque dans le hall d’entrée.
Une fois que la plainte est enregistrée, la machine judiciaire s’enclenche. Les policiers enquêtent : caméras de surveillance, téléphonie, portrait-robot… Tout est passé au peigne fin. Dans le cas de Gabrielle, ils ont récupéré les images des caméras de surveillance où le taxi a été vu place Stéphanie. Malheureusement, celles-ci ne donnent pas une image suffisamment précise pour identifier l’agresseur. Le plus dur, c’est de trouver quelqu’un qui n’est pas enregistré ou connu des services de police, « là c’est quasi impossible de le retrouver, même avec un portrait-robot », s’attriste Nicolas Ruggieri.
La machine judiciaire est longue, il faut en général deux ans pour avoir une réponse, traiter une plainte…Toute l’enquête prend un temps fou, surtout que l’on peut recevoir des devoirs complémentaires, parce que la victime ou le futur suspect souhaite qu’on auditionne telle ou telle personne, ce qui est dans leur droit.
Gabrielle reçoit un courrier quelques semaines plus tard. Lorsqu’elle se rend au commissariat Bruxelles/Ixelles au 30 rue du Charbon, l’inspecteur lui demande d’identifier des photographies. Devant elle, aucun visage ne lui parle. Elle ne reconnaît pas son agresseur.
« Dans ce cas la procédure est terminée… il n’y a rien d’autre à faire ! » lui dit l’inspecteur.
Gabrielle sort des lieux. La jeune fille ne prononce pas un mot, quelque peu choquée par cette fin abrupte. Toutefois, il est préférable de venir porter plainte, et ce même si le dossier n’aboutit pas. « Ça reste une goutte d’eau dans une bouteille. Si ça se trouve c’est la première goutte dans la bouteille mais ça peut aussi être la goutte qui va faire déborder la bouteille », explique une policière du service Jeunesse et Mœurs d’Etterbeek.
CHAPITRE III : LISA
Le procès

8h00. Il fait froid. La lumière peine à percer les murs épais de l’immense Palais de Justice de Bruxelles. Le carrelage lisse, les murs en pierres blanches et la hauteur du plafond révèlent la solennité de la Justice.
C’est dans cette immensité que les dépôts de plaintes sont envoyés. Chaque année, en Belgique, plus de 45000 dossiers sont enregistrés par les parquets, selon Amnesty International. Le dossier arrive donc en ces lieux avec un numéro de notice, le 37, conditionné à être incorporé à la section « mœurs », réservée à ce type d’affaires. Si le dossier comporte des éléments d’une gravité importante directement le parquet. Dans ce cas, le dossier passe par la voie « urgente ». Sinon, la plainte arrive par la voie classique.
Au sein du parquet, trois juges prennent la décision, après mûre réflexion, de classer le dossier sans suite ou de poursuivre l’affaire. « On ne classe jamais sans suite simplement sur base d’un procès-verbal initial sauf si l’auteur est vraiment inconnu et qu’il n’y a aucun moyen de recherche possible pour identifier l’auteur des faits », détaille la porte-parole du parquet de Bruxelles, Ine Van Wymersch. Mais une plainte classée sans suite n’est pas pour autant jetée à la poubelle. Elle est mise « au frigo ». Si de nouveaux éléments surgissent, le dossier ressort. ADN, nouveaux témoins, nouvelle victime… « À la demande du parquet, nous effectuons de nouveaux tests et de nouveaux prélèvements afin de chercher de nouvelles preuves matérielles », explique Charlène, infirmière légiste au CPVS, le Centre de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles à Bruxelles. Un classement sans suite n’est jamais définitif. Ce qui l’est en revanche, ce sont les prescriptions. « 10-15 ans après on ne sait plus poursuivre », explique le substitut du procureur du roi, Denis Goeman.
Lorsque le parquet décide de poursuivre l’affaire, « le juge d’instruction fait son enquête et décide de placer l’auteur des faits sous mandat d’arrêt ou non. Pour les faits graves, c’est le cas dans 98 % », explique Mr. Goeman.
80 % des plaintes ne débouchent sur rien
C’est d’ailleurs pour cela qu’une série de dossiers n’aboutissent pas. En effet, le taux de classement sans suite au parquet de Bruxelles « est hallucinant » : 80 % des plaintes ne débouchent sur rien, selon Florence de Cock, avocate. Pour elle, la politique criminelle basée sur les critères de gravité et les moyens matériels et financiers en sont la cause. Le manque de moyens oblige en effet à traiter en priorité ce qui est jugé « important », et autant le dire, les agressions qu’elles soient sexuelles ou non, ne sont pas une priorité dans la sphère juridique. Les affaires de mœurs sont très souvent prises à la légère, « pourtant une affaire peut vite tourner au vinaigre. Une affaire de coups et blessures peut finir en meurtre. Il faut être très attentif et sérieux », explique la policière du service Jeunesse et Mœurs.
Néanmoins, le parquet de Bruxelles consacre deux demi-journées par semaine, à savoir le lundi et le mardi matin à ce type d’affaires.
Ils lui ont imposé des attouchements (…) l’ont ensuite photographiée et filmée (…) Ils ont ensuite encaissé une somme de 40€ par deux hommes (…) pour avoir des rapports sexuels avec elle.
10h00. Une petite sonnerie retentit. Toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent. Pas un mot ne s’élève. On peut entendre le plancher grincer. Le président de la chambre et deux juges font leur entrée par une petite porte située au fond de la salle. Ils s’installent tous les trois, le président au milieu. À leur gauche se situe une greffière, à leur droite le procureur du roi « à l’origine de la demande au tribunal de siéger pour juger une personne », précise Denis Goeman.
Enfin, la parole est à la partie civile qui détaille sa position. Le président de la chambre demande le silence dans la salle. Vêtus de leur robe noire, les avocats de chaque partie se lèvent et défendent leur client tour à tour. Certains plaident des antécédents de jeunesses difficiles, un casier judiciaire vierge, remettent en cause certains éléments de l’enquête ou reportent la faute sur les autres prévenus. « Ils plaident une demi-heure, une heure, en règle générale, sauf s’il y a plusieurs victimes, là ça peut prendre plus de temps », raconte Ine Van Wymersch.
Manque de classe
Même si le milieu social ne préserve d’aucune agression, l’auteur d’infraction à caractère sexuel issu d’une classe sociale supérieure possède des moyens intellectuels de défense plus élevés. « Je fais une thérapie, j’ai déménagé, j’ai vu un psy, j’ai indemnisé la victime », sont des arguments qui rencontrent parfaitement les attentes de la Justice. Plus un individu a de ressources intellectuelles, sociales et financières, plus il est armé à faire face, notamment en se payant un avocat. « C’est comme le médecin, il y en a pour qui c’est facile et d’autre pour qui ça l’est moins », ajoute Florence de Cock. D’ailleurs, l’avocat a la possibilité de faire avancer un dossier plus rapidement, notamment en faisant du lobbying auprès du magistrat responsable du dossier. Avoir des moyens plus larges permet aussi de faire des recours, de faire appel et donc d’avoir pour finalité une justice plus nuancée. Des individus issus d’une classe populaire sont victimes d’une sous-représentation en plus d’être victimes d’une agression. « Ce n’est pas pour rien qu’il existe des lieux pour avoir des conseils juridiques gratuits car sans cela on est perdu dans le dédale juridique. Tout le monde n’a pas toujours les moyens d’assurer, sur le long terme, l’effort en justice », explique Olivier Slosse.
Frappée, dénudée, prise en photo, prostituée, violée… Aujourd’hui, la victime a été hospitalisée en hôpital psychiatrique pendant de longs mois. Elle reçoit depuis la dernière audience des appels et des sms de menaces.
Une fois que les plaidoiries sont entendues, le juge prend l’affaire en délibéré, ce qui signifie qu’il va prendre un mois environ pour réfléchir à son jugement final. « Il étudie le dossier avec les éléments nouveaux qu’il a peut-être entendus pendant la plaidoirie », poursuit la porte-parole du parquet de Bruxelles.
13h00. L’audience se clôt. Dans un bruit assourdissant, les membres de la salle se lèvent avant de rejoindre la sortie. Pour la victime, l’attente est interminable. « Frappée, dénudée, prise en photo, prostituée, violée… Aujourd’hui, la victime a été hospitalisée en hôpital psychiatrique pendant de longs mois. Elle reçoit depuis la dernière audience des appels et des sms de menaces », rapporte son avocat. « Ce sont des faits inouïs de violence et je crois que ma cliente a de la chance d’être en vie », poursuit-il.