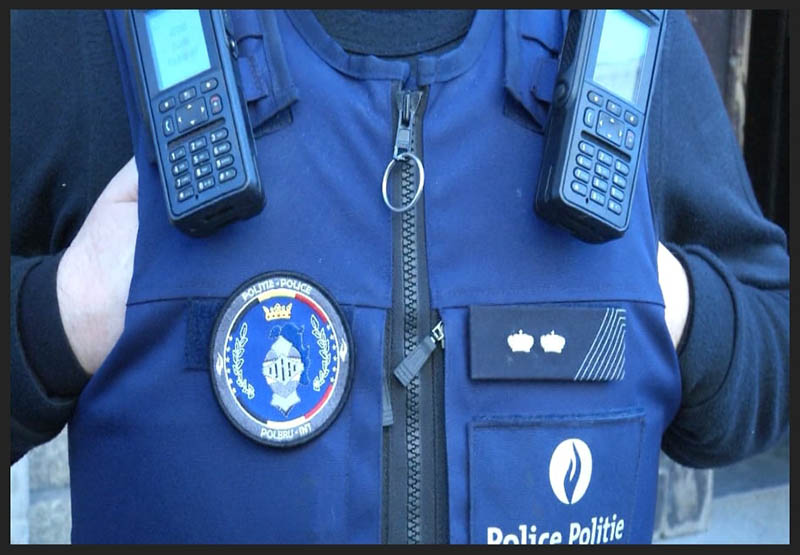La justice s’écrit (aussi) au féminin
Remarques déplacées et cas de harcèlement : la Justice ne déroge pas au sexisme systémique qui compose la société. Pourtant, depuis #MeToo, les choses ont-elles vraiment évolué?

Qu’il s’agisse de propos sexistes entendus dans des cabinets ou au Palais de Justice, la question des femmes semble, encore en 2019, poser un sérieux problème à l’appareil judiciaire. Si elles ont été nombreuses à dénoncer, il y a plus d’un an, leurs agresseurs sur les réseaux sociaux sous les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc, qu’ont réellement changé ces prises de parole ? Dans le milieu de la Justice, les femmes peinent à asseoir leur légitimité, tant au niveau des magistrates, souvent reléguées à leur seul statut de « femmes », qu’à celui des stagiaires victimes de harcèlement, dont la parole peine à se faire entendre. Autant d’éléments qui interrogent le rapport entre justice et femmes et posent du même temps, les enjeux du féminisme dans la sphère judiciaire. Car culpabilisation et remarques misogynes agissent toujours comme des ressorts efficaces dans ce milieu professionnel, et malgré un arsenal législatif déjà existant punissant ces dérives, les mentalités évoluent lentement.
Après #MeToo, le retour de bâton ?
De fait, si le mouvement a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux, c’est qu’il est révélateur d’un système d’oppression subi par les femmes. Au travers de ces nombreux témoignages égrenés un peu partout sur le web, une impression de sororité, de bienveillance et de soutien a émergé, encourageant celles qui n’osaient pas encore, à prendre également la parole, munies de leur clavier, d’une connexion Internet et de beaucoup de courage. Pourtant, en réponse à cette vague de tweets dénonciateurs, une même interrogation : racontent-elles la vérité ?
Le souci de la véracité des propos tenus et de leur légitimité sur le Web fait écho à ce que vivent les femmes victimes de harcèlement et d’agression dans la réalité. La remise en cause de cette parole, ce « retour de bâton », comme l’a théorisé la journaliste et écrivaine féministe Susan Faludi, pose en effet la question de l’impact réel de la prise de parole des femmes, notamment dans la Justice, un terrain où la neutralité et l’écoute sont pourtant de mises. Pour Irène Zeillinger, éditrice de l’association féministe Garance, si #MeToo a apporté un sentiment de communauté, « de ne plus être seule avec ce vécu, de se rendre compte que ça touche énormément de femmes, de toutes les couches sociales, de toutes les origines », une fois extrait des réseaux sociaux et passé le buzz éphémère propre à tout mouvement né sur la Toile, le « mécanisme d’oppression sexiste se remet en marche. »
Pourquoi existe-t-il encore un tel tabou sur les questions d’émancipation et d’égalité effective ? Pourquoi suscitent-elles tellement de tensions ? Parce qu’elles ne sont pas acquises, quoi qu’on en dise.
Chloé Harmel
Un secteur historiquement masculin
Si au niveau européen, la Belgique peut se prévaloir d’être l’un des pays où les lois sont les plus égalitaires, dans la pratique, force est de constater l’échec en termes d’effectivité des droits et de l’accès qui leur sont consacrés. L’adoption de la Convention d’Istanbul par la Belgique en 2016 en est l’illustration. Promulgué par le Conseil de l’Europe, ce texte vise à prévenir et à lutter contre toutes les formes de violence faites à l’égard des femmes grâce à sa structure en quatre points : politiques intégrées, prévention, protection et poursuites. Peu médiatisée, la convention est pourtant le premier texte à être réellement contraignant pour chaque état qui le ratifie. Une avancée inédite pour les droits des femmes que la Belgique devrait normalement être tenue de mettre en application. Pourtant, on ne peut que constater que son aspect contraignant est encore loin d’être effectif. « La réalité est que la justice a un problème pour le moment avec les femmes. Ça mérite d’être énoncé de façon explicite », assure Chloé Harmel. Si le ton est si affirmatif, c’est bien parce qu’elle le constate au quotidien : « L’un des combats de l’association est de faire évoluer le droit différemment, par l’intervention individuelle des avocates membres, d’essayer de discréditer le raisonnement ou le vide juridique actuel qui consiste à ne pas prendre en considération les cas de violence. »

Des manquements législatifs aux traitements partiels des affaires de mœurs en passant par le peu de considération accordée aux femmes au sein même de la profession, ces différents facteurs participent à entretenir la bonne santé du sexisme dans la justice. « Le problème aujourd’hui, n’est pas tellement d’admettre que certains hommes sont violents ou de prendre leur cas individuel, il est de considérer que l’appareil légal et réglementaire autorise et même, valorise la violence qui s’exerce sur les femmes, parce qu’il n’est pas suffisamment réactif ni rapide et n’offre pas la protection ni le suivi requis. »
Milieu traditionnellement masculin, le droit a longtemps été l’apanage des hommes issus des classes sociales supérieures. Si depuis septante ans, les femmes ont investi les cours de justice et les cabinets, l’application parfois contestée de certains textes de loi relatifs aux femmes pourraient s’expliquer par cette répartition, numériquement égalitaire et pourtant, pas encore tout à fait efficiente en termes qualitatifs. « Historiquement, le droit apparaît comme une profession de pouvoir où les hommes sont très loin des considérations quotidiennes qui touchent les femmes. Quand elles sont arrivées, les femmes ont apporté un regard nouveau, mais ont également dû lutter contre des siècles de culture professionnelle qui ne les prenaient pas en compte », explique Adeline Cornet, auteure d’une thèse sur la répartition du genre dans la justice. Si le droit et la justice ne dérogent pas au sexisme systémique qui touche l’entièreté de la société, le fait que les hommes aient occupé depuis toujours des postes de pouvoir expliquerait que les femmes peinent encore aujourd’hui à acquérir une certaine légitimité au sein de la profession, et ce, même si elles ont investi les bancs de l’université et les bureaux des cabinets depuis cinquante ans.
De l’université au Palais de Justice, un sexisme omniprésent ?
Dans ce contexte, s’imposer en tant que professionnelle requiert tout à la fois d’accepter ce système inégalitaire pour espérer prétendre évoluer et en subir, du même temps, les conséquences pour ne pas être d’emblée disqualifiée. Car, au-delà du seul aspect législatif, l’environnement de travail lui-même est imprégné de ces déséquilibres genrés. Des amphithéâtres aux salles d’audience, les femmes devraient sans cesse composer avec les remarques sexistes et les recadrages gratuits de leurs comparses masculins.
La justice a un problème pour le moment avec les femmes. C’est vrai et ça mérite d’être dit.
Chloé Harmel
C’est notamment le cas de Mathilde, jeune juriste bruxelloise de 26 ans, dont le parcours professionnel a été traversé par les réflexions malvenues, les blagues grivoises et certains comportements parfois déplacés. « Une fois, lors d’un cours magistral en droit de la propriété, pendant lequel je discutais avec mon voisin, le prof l’a interpellé pour lui demander d’arrêter de me « courtiser », en précisant que l’on sentait que j’étais déjà sous son charme. Il n’a pas manqué de préciser à mon voisin et devant les 500 personnes présentes, qu’il pouvait disposer comme il lui plaisait de moi, et en faire usage et habitation s’il le voulait. »
Après la prise de parole, les actes ?
Finalement, symptomatique d’un milieu où les affaires de harcèlement moral ou physique et d’agressions sont courantes, l’histoire de Mathilde entre en résonance avec celles de nombreuses autres juristes dont les témoignages peuplent le compte @PayeTaRobe. Sur le modèle de la page Facebook @PayeTaSchnek, dont l’idée initiale est de mettre en exergue les réflexions misogynes entendues quotidiennement, @PayeTaRobe se concentre sur le monde la justice.
Avant mon premier jour : On me prévient de ne pas oublier de venir en talons.
— Payetarobe (@Payetarobe) 3 juillet 2018
Associé à collab : “votre naïveté m’inquiète pour votre vertu. Vous me faites penser aux filles faciles qui pullulaient dans les boîtes à mes 18 ans et qui disaient toujours Oui aux garçons en souriant niaisement”.
— Payetarobe (@Payetarobe) 17 juin 2018
« Associé : je ne comprends pas la féminisation de la profession. Vous les femmes, vous êtes faites pour avoir des enfants, pas pour travailler. C’est l’ordre naturel des choses. » ; « Discussion entre associés : les deux stagiaires je ne sais pas si elles travaillent bien, mais au moins elles sont jolies à regarder » et autres réflexions archaïques alimentent ce fil Twitter révélateur du sexisme ambiant qui règne dans les cabinets et de la difficulté pour les femmes de prendre leur place dans un monde où la camaraderie semble exclure toute forme de mixité. En témoigne, l’initiative portée en 2016 par le Carrefour des stagiaires, d’instaurer une charte anti-harcèlement, étendue à l’ensemble de la profession. Soutenu par Jean-Pierre Buyle, président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones (OBFG), et calqué sur un modèle similaire adopté par le barreau parisien, le projet aurait été catégoriquement refusé par le barreau bruxellois, sous l’ère de Pierre Sculier. Si ce dernier réfute cette information, arguant « qu’une structure interne ayant la même vocation existait déjà », force est de constater que les cas de harcèlement avaient toujours cours au sein des cabinets. Selon Louis Godart, avocat au barreau de Bruxelles qui a monté depuis, une cellule d’aide aux juristes victimes de harcèlement : « Il y a des cas de notoriété publique. Des choses dont nous sommes au courant malheureusement, qui ont été couvertes. Des maîtres de stage qui ont été interdits par le barreau de recruter de jeunes juristes en raison de leur comportement, mais qui restent en place malgré tout. »
On sait identifier les avocats présumés harceleurs. Même s’ils sont connus, il ne se passe rien. Il persiste une sorte de mutisme certainement lié au copinage, qui explique un manque d’action.
Louis Godart
Des mécanismes qu’il tente de déconstruire grâce à cette cellule qui, aidée d’une psychiatre, apparaît comme un espace de parole où les victimes peuvent être entendues et crues. Sans aller systématiquement jusqu’à la plainte, cette cellule permet d’identifier les présumés harceleurs et de soutenir les juristes qui n’osaient pas parler jusqu’alors, le réseau et le copinage inhérents à la profession pouvant briser une carrière. « Le monde du barreau fonctionne sur des dynamiques informelles, des réseaux de connaissance qui se tissent généralement en dehors des heures de travail. Cela se répercute évidemment sur les mères, les jeunes parents ou toute personne qui n’aurait pas envie de passer son temps dans le monde du travail. Ce système apparaît dès lors comme une double peine et explique le décalage avec la réalité », décrypte Adeline Cornet.
Le monde reste très fortement teinté d’une large empreinte masculine. Les rôles genrés ne vont pas changer demain. Cela va prendre des décennies.
Adeline Cornet
Loin d’être un cas isolé, le Justice s’inscrit finalement dans une société où le sexisme est structurel et agit dans tout secteur professionnel, classe sociale, à chaque moment de la vie d’une femme. Dès lors, l’enjeu n’est pas tant de pointer du doigt les déséquilibres inhérents à cette profession que de les inscrire finalement dans un phénomène systémique : « Ce n’est pas la faute du barreau, mais du monde professionnel qui est la conséquence de siècles d’éducation genrée. C’est la société qui pose soucis », conclue Adeline Cornet. Depuis #MeToo, les femmes dénoncent ces comportements au même moment où les hommes commencent à en prendre doucement conscience. Finalement, qu’il s’agisse du monde médiatique, de l’industrie du cinéma ou encore, de la politique, chaque secteur voit ses dynamiques d’oppression mises à mal. Reste à espérer que la Justice soit la prochaine à agir.