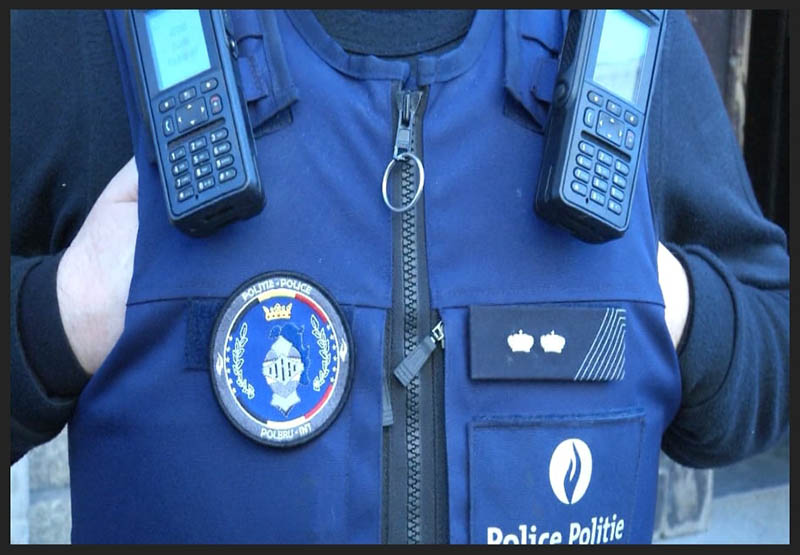Le délit politique aux abonnés absents des cours d’assises
Le délit politique n’a jamais été clairement défini et son utilisation est constamment rejetée. Un outil judiciaire mis au placard… à tort?
D’une part, le droit d’être renvoyé devant les assises est garanti par la Constitution pour les auteurs de délits politiques que le ministère public jugerait opportun de poursuivre, tandis que, d’autre part, aucune norme juridique ne définit ce qu’est le délit politique.
Eric Van Brustem, stagiaire judiciaire et juge suppléant au Tribunal de première instance du Hainaut.
Vous souvenez-vous du dernier délit politique jugé en Belgique ? La plupart des magistrats et des avocats ne se le rappelle pas : « c’était peut-être par rapport aux élections… », « ça doit remonter à l’immédiat d’après-guerre… » Même une recherche poussée sur Internet n’amène qu’à de vagues réponses. Mais qu’est-ce donc que le délit politique ? Pourquoi le concept est-il tombé en désuétude ? Devrions-nous nous méfier de son absence dans les tribunaux ?
La naissance du concept de délit politique est liée à son contexte historique, nous raconte Jean-Marie Demargne, porte-parole du SAD (Syndicat des avocats pour la démocratie). « Les révolutionnaires de 1830 venaient de combattre puis de vaincre le régime hollandais. Quand ils ont rédigé la Constitution, ils ont été très sensibles à la protection des libertés publiques. Par réflexe contre l’arbitraire, dont peut faire preuve un pouvoir pour lutter contre ses opposants, le judiciaire n’était pas exonéré de leur méfiance. C’est pourquoi ils ont souhaité que les délits politiques soient jugés par un jury populaire. Toutefois, ils ont perdu de vue que ce sont des magistrats qui aiguillent une affaire vers les tribunaux ordinaires ou les Cours d’assises. », raconte-t-il.
La Cour d’assises, ce gros mot juridique qui donne la migraine à ses praticiens, parlons-en. Son utilisation pose problème, en général, à cause de la procédure jugée trop lourde et qui, en cas de cassation du verdict, finit par rappeler une autre Cour d’assises. De plus, les risques de cassations sont beaucoup plus élevés que dans les cas où la décision revient à des magistrats professionnels. Telles étaient les raisons évoquées par le Conseil Supérieur de la Justice pour justifier son positionnement en faveur de la suppression de cette juridiction en 2015-2016. Manuela Cadelli, magistrate et présidente de l’ASM (Association syndicale des magistrats), le confirme : « si on ne juge plus les délits politiques, c’est surtout à cause du coût de la Cour d’assises à mobiliser plus qu’à cause d’une tribune qu’on ne voudrait pas octroyer aux accusés. » Ce sont les procureurs du roi et leurs substituts qui définissent les actes posés et donc dans quel tribunal ils devront être jugés. Pour le premier substitut du procureur du roi au parquet de Mons, Frédéric Bariseau, les Cours d’assises sont suffisamment encombrées : « si on devait amener tout ce qu’on pense être un délit politique devant la Cour d’assises alors que rien qu’avec les crimes de sang elle est déjà bien occupée… C’est certainement déjà une des raisons qui amène à qualifier de façon plus légère les faits. »
Les motivations politiques mises de côté
Par cette remarque, M. Perrouty a tenté de nous faire remarquer un autre phénomène : bien que l’on n’utilise plus ce concept, les infractions motivées par des raisons politiques, sont malgré tout poursuivies, mais différemment. Prenons quelques exemples :
Maître Marc Neve est l’un des avocats de Green Peace : « On a plus d’une fois défendu les activistes en soutenant qu’il s’agissait de délit politique. Il était question principalement d’actions qui concernaient l’occupation de locaux ou de terrains où se trouvent les centrales nucléaires. Il faut savoir, en résumé, que la législation visant à la protection de ces sites est une législation tout à fait particulière parce que ce sont des sites assimilés à des zones militaires et donc qui peuvent entraîner l’intervention de l’armée en cas de violation d’un certain périmètre. Il y a, en ce qui concerne ces zones, une réglementation spécifique par rapport à la sécurité nationale. Au regard de ces dispositions tout à fait exceptionnelles, nous avons proposé une défense qui, comme telle, est tout à fait exceptionnelle également. » L’avocat l’assure, à chaque fois qu’ils ont utilisé cette défense, dans aucun des cas, le juge n’a reconnu qu’il était effectivement question d’un délit politique.

Le 7 février 2012, des militants ont pénétré dans le terrain militaire du SHAPE (qui est l’un des deux États-majors militaires stratégiques, celui-ci se trouve à Mons et l’autre aux États-Unis) et ont publié sur YouTube la vidéo de leur intrusion. Ils ont été poursuivis pour délit contre la sûreté extérieure de l’État (article 120 du Code pénal). Leur but était d’inspecter les lieux et présenter un questionnaire aux personnes qu’ils pouvaient rencontrer sur place pour répondre aux interrogations qu’ils se posaient « en tant que citoyens pacifistes » à propos des bombardements de l’OTAN dans ses missions à l’étranger. Leur avocat a plaidé le délit politique qui, comme pour les affaires de Marc Neve, a été rejeté. Les conclusions du tribunal correctionnel du 3 novembre 2015 indiquent qu’ « il n’est question d’un délit politique que si ce délit a, ou a pu avoir comme conséquence, une atteinte portée directement aux institutions politiques. » Il est également spécifié que les magistrats ont préféré adopter une approche restrictive du délit politique étant donné la lourdeur procédurale que cela impliquerait. Autrement dit, faire appel à la Cour d’assises les ennuyait fortement.
Le 10 avril aura lieu le procès d’Hugo Périlleux Sanchez, un militant contre le TTIP (un traité de libre-échange transatlantique entre l’Europe et les États-Unis). Vous souvenez-vous, en 2016, du panneau Coca-Cola de le place de Brouckère qui a affiché un tout autre message,« TTIP Game Over – No more negociation – No more free trade deals – It’s time for action » ? Hugo faisait partie de ceux qui ont changé la face de cet écran, symbole du capitalisme. Prochainement, il sera seul face au juge et au procureur du Roi. Même Coca-Cola et Clear Chanel, (également usurpés), n’ont pas réclamé de dédommagements. Le côté politique de cette action ne peut passer inaperçu. « Oui, cela pourrait tout à fait être un délit politique. C’est l’expression d’une opinion par rapport à des événements politiques et par rapport à une situation bien précise défendue sur le plan politique » défend Marc Neve, qui, précisons-le, n’est pas l’avocat de l’activiste. Pourtant, Hugo Périlleux Sanchez n’est aujourd’hui poursuivi que pour piratage et sabotage informatique. Le substitut du procureur du Roi, Frédéric Bariseau, l’affirme : lui non plus n’aurait pas qualifié ces actes de « délits politiques ». « Depuis la création de cette loi pénale sur le délit politique, le Code s’est adapté aux nouvelles technologies, aux nouveaux mouvements… L’arsenal juridique a augmenté, notamment avec la loi sur le terrorisme », conclut-il.
En 2003, une loi relative aux infractions terroristes a en effet été introduite dans le Code pénal en l’article 137. Dans le papier de Martin Moucheron, criminologue, « Délit politique et terrorisme en Belgique : du noble au vil » (2006), on comprend que la finalité de cette loi est de définir ce qu’est le terrorisme afin de mieux le poursuivre et d’adapter les peines, « systématiquement majorées par rapport aux délits de droits communs [délits « ordinaires »] ». L’autre conséquence de cette loi est finalement que ce qui tenait du délit politique peut, dans certains cas, être associé à du terrorisme. Selon le texte de Martin Moucheron, « l’élément moral « politique » retenu dans la définition de ces infractions est conçu comme une circonstance aggravante, et contredit ainsi le principe du régime de faveur établi aux premières heures de la Belgique et progressivement restreint dans son application. » Autrement dit, pour qu’un délit soit catégorisé de terrorisme, il faut, au moins, qu’il ait un caractère politique.
« Une régression démocratique »
Nous voilà face à une question plus philosophique : le peuple ne peut-il pas tenter de modifier le fonctionnement des institutions, de changer les lois au moyen de l’activisme ? De s’insurger contre une décision, à l’instar de ce que font les déjà très populaires Gilets jaunes, en France et en Belgique ? D’ailleurs, Jean-Marie Demargne affirme au nom du Syndicat des avocats pour la démocratie que « nous avons dénoncé et combattons toujours les législations qui, sous couvert de lutte antiterroriste, restreignent considérablement le champ des libertés publiques car nous ne voulons pas encourir les foudres que Benjamin Franklin promettait à une société prête à sacrifier ses libertés pour plus de sécurité : ne plus mériter ni les unes ni l’autre… »

De plus, les membres de la Ligue des Droits Humains ont constaté une augmentation de la criminalisation des mouvements sociaux, comme ceux dont nous avons évoqué les procès précédemment. Manuela Cadelli apporte une explication clairvoyante : « les mouvements sociaux sont en augmentation depuis la crise de 2008. On est mieux informé, on a ouvert des débats publics… et donc il y a plus de place pour des revendications citoyennes et donc on arrête davantage [de militants]. » Finalement, c’est le Parquet invoqué qui décidera si l’on poursuit ou non, et certains sont plus « cléments » que d’autres, évidemment. En général, le Parquet juge ces actes comme des « infractions de droit commun », autrement dit, des « infractions qui ne portent pas atteinte à l’ordre politique », ce qui refuse aux accusés le droit de se défendre en Cour d’assises, qui constitue en elle-même « une chambre d’écho judiciairo-médiatique » pour citer M.Perrouty, soit une sorte de tribune pour qui veut ouvrir un débat.
Poursuivre ces personnes qui mènent des actions tout en ne permettant pas « l’écho suffisant » au débat qu’elles ouvrent quant à l’ordre établi, est-ce encore démocratique ? Pour la magistrate, Manuela Cadelli, c’est clairement « une régression démocratique » de ne plus invoquer le délit politique et surtout de ne plus le juger comme tel. M. Perrouty répond à cela : « Cela dépend de votre avis sur l’ordre établi en général. Si vous voyez l’ordre établi comme le résultat d’un ordre démocratique et de lois votées démocratiquement, et bien, quelque part, oui, c’est démocratique. En revanche, si vous voyez cela comme le produit d’un rapport de force et d’une domination économique, alors non c’est injuste par définition… C’est démocratiquement valable, mais injuste. » Le directeur de la Ligue des Droits Humains se positionne en faveur d’une décriminalisation de ces mouvements sociaux. Le porte-parole du SAD, (Syndicat des avocats pour la démocratie), apporte une autre réflexion : « plus on s’éloigne des périodes révolutionnaires et plus les pouvoirs réussissent à ancrer dans les esprits l’idée que « l’on vit en démocratie ». Il devient ainsi davantage difficile pour les auteurs d’infractions de revendiquer le caractère politique de leurs actes. Comme l’immense majorité des procureurs (qui sont à l’origine des poursuites) et des juges sont, consciemment ou non, des défenseurs de l’ordre établi, ils sont convaincus qu’un délit politique est avant tout un délit, le mobile de l’auteur n’étant en quelque sorte que secondaire. »
Nous sommes dès lors dans un monde où l’on s’insurge face à la politique mise en place, un monde où certains citoyens se sentent impliqués et veulent faire bouger les choses, mais la Justice ne semble pas vouloir les écouter. « Si on les criminalise, je pense que c’est pour préserver l’ordre établi et dissuader, on donne une sanction pour donner un signal », pointe le président de la Ligue. « C’est une façon de maintenir un rapport de force avec les activistes », précise Manuela Cadelli.
Finalement, on pourrait se poser toutes les questions du monde sur nos démocraties que le système ne changerait pas. Marc Neve l’affirme : « Le délit politique a été vidé de son sens. » La procédure lourde qu’il implique et le manque de définition claire ont mené à une restriction considérable de son champ d’application. Il ne concerne désormais plus, selon l’avocat de Greenpeace, que « ce qui porte gravement atteinte aux institutions », sans définir, non plus, ce qui ressort de cette gravité. Beaucoup l’affirment : le délit politique est mort-né.